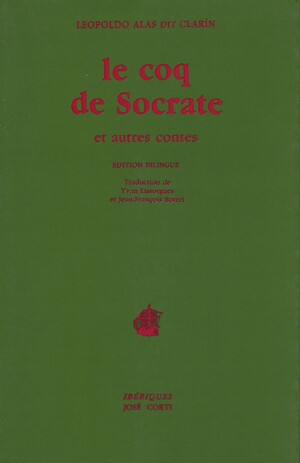Le coq de Socrate
Traduction de Jean-François Botrel et Yvan Lissorgues.
En cette fin du XXe siècle où, nous dit-on, la Terre se réchauffe dangereusement, parce que le Prométhée occidental, déchaîné, attise tous les feux d’une puissance effrénée qui dévore toujours plus la ligne de l’horizon ; en notre époque de compétition acéphale, où les centrifugeuses du progrès projettent sur des écrans divers les cervelles hors des crânes, où le culturel occupe l’espace de la culture, où l’art devient spectacle monnayable, où l’oubli gagne la racine profonde des mots qui s’échangent dans l’écume de leur surface et où seuls la littérature et l’art non contaminés par les valeurs marchandes préservent de la défaite de la pensée, l’œuvre de l’écrivain espagnol Leopoldo Alas dit Clarín (1852–1901) et en particulier Le coq de Socrate et autres contes pourrait apparaître comme une résurgence de l’authenticité et comme une invitation à un retour aux sources des valeurs essentielles.
Or les valeurs essentielles, aujourd’hui comme hier, sont des valeurs limites, aux portes du mystère : mystère du temps et de l’exister, mystère de l’amour et de la mort, mystère du désir… et du langage. C’est pourquoi l’écriture littéraire authentique, celle qui n’est pas simple jeu sur les mots ou pure évasion mais recherche de la conscience, est toujours, hier comme aujourd’hui, une tentative de transgression des frontières ; elle est la poétique expression du désir aux prises avec ses limites, au-delà des poreuses frontières du langage. Tel est le signe de l’œuvre littéraire la plus profonde de Clarín : réalité et poésie.
Ses deux romans, La Regenta, 1884–1885 (La Régente, Fayard, 1987), considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature universelle, Su unico hijo, 1891 (Son fils unique, Fayard, 1990), les cent six contes ou nouvelles publiés de 1876 à 1901 dans la presse ou en recueils, sont des re-créations imaginatives si profondément enracinées dans un espace et dans un temps qu’elles retrouvent, au-delà de la satire d’un monde prosaïque ou dégradé, l’humus premier de l’homme profond, avec ses aspirations, ses rêves, ses fantasmes, ses désirs :
Fondamental tissu d’affection vitale déchiré par une criante et stupide réalité d’injustice (Adieu, La Douce !), tension vers l’autre inaccessible, vers l’amour impossible (Le duo de la toux, L’enterrement de la sardine), tragique et pathétique désir du moribond, au milieu de la sordide cupidité des « siens », de retrouver dans Le pain jaune le paradis maternel de l’enfance, fuite désenchantée de Varius vers l’illusion d’un idéal pur qui s’ouvre sur la mort, voyage circulaire d’une existence de recherche rationnelle et positive qui, grâce à la mère, retrouve la source du divin…
En cette quête, la raison ne conduit qu’à la géométrie des choses (Le coq de Socrate), là où seule l’intuition poétique illumine les réalités profondes.
Yvan Lissorgues
Presse et librairies
Ces dix contes, publiés à l’origine dans la presse, sont autant d’invites à réfléchir un instant sur les fondements de l’existence, sans raideur, au hasard de contes allégoriques ou burlesques, remarquables de simplicité, de drôlerie et de finesse. Comme si, un soir de fête, Clarín avait réuni pour un gorgeon Maupassant et Goya.
Lire, janvier 1993Les récits, rassemblés dans ce volume, rappellent les “portraits à la silhouette” et les caprices de Goya. Ce chanoine troublé, ce fou médium, ce fermier illetré ne sont que les fragments d’une réalité humaine et sociale que Clarín, tel Maupassant ou Courbet, nous restitue avec bonheur.
Gérard de Cortanze, Le Figaro, 16 janvier 1993