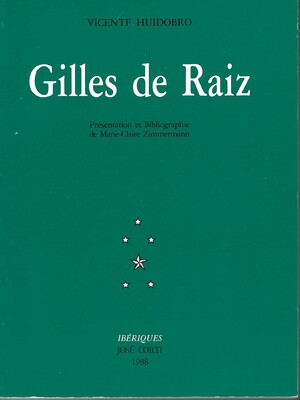Gilles de Raiz
Traduction de Marie-Claire Zimmerman.
Une pièce de théâtre de l’écrivain chilien Vicente Huidobro sur l’homme auquel plus de 200 ouvrages ont été consacrés ; une “lecture” iconoclaste et flamboyante d’une légende éternelle dans laquelle Huidobro convoque Barbe-Bleue, bien sûr, mais aussi le Marquis de Sade, Don Juan, Huysmans, Bernard Shaw, etc., et Huidobro lui-même.
“Un homme est plus sa légende que lui-même” (p. 280).
Le “monstre sacré” auquel Georges Bataille consacra soixante-sept pages terriblement personnelles, en guise de prologue à la publication du procès de Gilles de Rais, suscite depuis la fin du XVIIIe siècle, des interprétations contradictoires. Ses détracteurs voient en lui le parangon des criminels, le pervers absolu, touché par le repentir avant son exécution – ce qui ne saurait surprendre chez un Chrétien du XVe – puis mené au supplice au milieu d’une vive émotion populaire, tandis que les historiens et les essayistes du début du XXe siècle ont tenté de réhabiliter celui qui fut, peut-être, l’innocente victime d’une machination judiciaire et politique. Tous ceux que le seigneur de Machecoul et de Tiffauges a inspirés se sont cru obligés de prendre parti. Sauf Michel Tournier dans Gi/les et Jeanne, libre narration qui, se nourrissant de différentes sources fictives et d’abord des avatars de sa propre écriture, se situe résolument hors de tout débat. Sauf aussi Vicente Huidobro (1893–1948), écrivain chilien issu d’une noble famille qu’il quitta pour se rendre en Espagne et en France où il vécut passionnément diverses aventures littéraires, auteur d’une pièce intitulée Gille de Raiz, que la librairie José Corti publia en 1932 aux Éditions Totem, qu’elle présente à nouveau aujourd’hui à des lecteurs français qui ignorent généralement l’œuvre et jusqu’au nom même du poète.[…]
L’invention théâtrale réside dans le fait de ne presque rien montrer à l’œil, pour privilégier l’oreille, soit que l’on parle de l’horreur, soit que l’horreur devienne perceptible auditivement. Aucun acte de violence ne se déroule sur les planches. Gilles ne tue, ne blesse ni ne viole en présence du public. Certes il porte un enfant mort dans ses bras au troisième acte et cette seule image a un terrible pouvoir de suggestion, mais rien n’est dit sur les circonstances de ce décès: seuls les gestes de Gilles, ses yeux hagards, ses hurlements, divers signes de la folie et du délire d’un moment, inclinent le spectateur à franchir le silence imposé par l’ellipse et à imaginer le non-dit, si profusément décrit dans les pièces d’archives du procès.
Dès les premières répliques le public est contraint d’accepter auditivement l’insoutenable. De manière subtile et efficace l’auteur met en œuvre la souffrance, ouplutôt les conséquences de la cruauté, aussi bien chez les victimes de Gilles que chez Gilles lui-même. La pièce consiste en un chant multiple de l’inhumaine douleur. Les êtres subissent la destruction physique de leur corps et sont broyés, à force de baisers ou de sévices. Seule la parole rend compte des effrayantes fêtes charnelles que le personnage nommé La femme (acte 1) a connues avec Gilles de Rais et dont elle garde une incurable nostalgie : “… Mais il regardait toujours loin, il regardait toujours loin et brusquement il enfonçait en moi ses griffes en hurlant” […]
Le Gilles de Raiz inventé par Vicente Huidobro est un homme qui se définit avant tout par un amour démesuré pour les femmes ; celles-ci surgissent et s’effacent pendant toute la pièce, Gila, la femme, les sept princesses, Soriele, Aladine, Isamoune…, le corps féminin faisant l’objet de divers hymnes et éloges langagiers (p.95). Lorsque Lucifer demande à Gilles s’il persiste dans sa passion pour les femmes celui-ci répond avec véhémence : “Plus que tout au monde. La femme, c’est l’amour, le reste… ne doit être que l’exaspération”(p. 93). Gilles voue un culte à l’amour parce que celui-ci est source de sensations sublimes, parce qu’il métamorphose tout l’être, corps et esprit, instaurant un état inconnu où s’allient joie et angoisse, livrant passage à un Moi nouveau, soudain possédé d’un heureux délire ou d’une bienfaisante folie (p. 94). Ce Don Juan hédoniste qui fut le compagnon quotidien de Jeanne d’Arc, et qui, peut-être, se sentit ému de reposer auprès de « ce visage de vierge endormi », n’a cependant éprouvé aucun amour pour la pucelle, parce qu’elle n’avait aucune beauté, dit-il, (p. 92), « parce qu’elle était soldat avant que d’être femme » (p.93), parce qu’elle demeurait étrangère à l’amour (p. 92), et les propos facétieux tenus par le diable au sujet d’une éventuelle équivoque des rapports avec cette femme-homme ou homme-femme, sont négligemment esquivés par un Gilles dont les vices, supposés tels, demeurent secondaires face à une passion dévorante et exclusive des femmes. […]
Aucune ne regrette les souffrances éprouvées puisque le paroxysme érotique est à ce prix.
Extrait de la préface de Marie-Claire Zimmermann
Presse et librairies
L’étude de la langue, des échanges entre le français, la poésie de Huidobro, ravissent. On peut parler d’un texte flamboyant et unique, qu’il faut absolument lire et connaître.
Michel Scheider