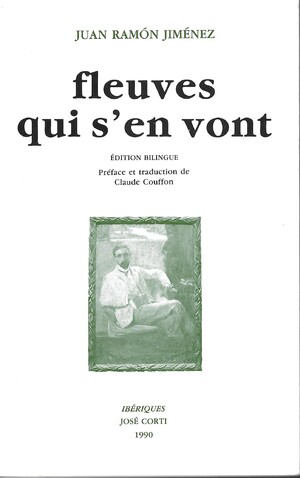Fleuves qui s’en vont
Traduction de Claude Couffon.
Les poèmes de Juan Ramón Jiménez qui suivent, écrit à partir de 1947, mais principalement de 1951 à 1954, ont pour constantes la sublimation de l’amour, le bonheur fragile, et surtout la mort et ce mystère : l’au-delà. Le titre du recueil, emprunté à un vers célèbre de Jorge Manrique, la suggère avec force. Certes, le thème n’est pas nouveau dans l’expression lyrique de Juan Ramón. Il correspondait à une terreur morbide née durant l’enfance, alors que fils heureux et choyé de riches viticulteurs, il perdit son père de mort subite, en 1900. Les conséquences furent un mal pulmonaire qui le conduisit durant cinq ans de sanatorium en sanatorium. La névrose d’une “mort imaginaire” est présente dès les premiers recueils et l’obséda toute sa vie, constituant l’un des pôles de sa poésie.
Mais ce qui avait été longtemps “imaginaire” devint avec les deuils ou leur menace et l’approche réelle de l’expérience entre le centre cruel de la recherche poétique. Pour cet homme qui n’avait vécu que pour et par la poésie, la mort ne devenait pas seulement une interrogation angoissée sur le destin d’un corps – le sien et celui des êtres chers – mais aussi sur l’avenir d’une œuvre élaborée avec soin, écrite patiemment, avec un regard extérieur et un regard intérieur sans cesse en éveil, comme une justification que l’on voudrait totale et indestructible de la vie.
Et pour se rassurer peut-être, le poète conçoit parfois que la mort, compagne de la vie, disparaît avec sa victime, et que c’est elle qui meurt vraiment, l’être humain renaissant, lui, dans les racines de la terre.
Le doute, avec sa petite lueur d’espoir clignotant de temps en temps dans l’obscurité du devenir, allait faire naître un livre qui est l’un des derniers chaînons d’une œuvre que son authenticité et les dons exceptionnels de son auteur placent au plus haut de la poésie universelle moderne.
Presse et librairies
Maturité, maîtrise du langage poétique, n’altèrent ni n’apaisent l’élan premier, d’autant plus intact qu’il s’épure, trouve sa juste tonalité.
Patrick Kéchichian, Le Monde, 21 décembre 1990