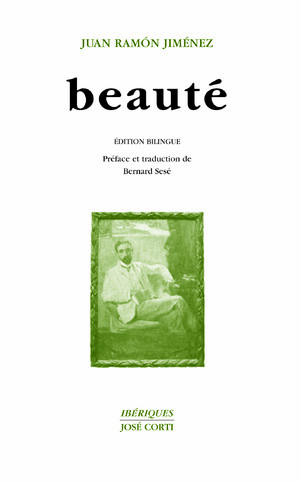Beauté
Traduction de Bernard Sesé.
Juan Ramón Jiménez malgré son Nobel n’occupe toujours pas en France la place qu’il mériterait.
Belleza est le septième recueil publié par Corti, cinq ayant été traduits par Bernard Sesé qui est aussi le traducteur de Jean de la Croix, Zorrilla, Fray Luis de León notamment.
« Le poète est l’homme qui a en lui un dieu immanent, et comme le médium de cette immanence. » Juan Ramón Jiménez (1881–1958) définit ainsi, dans son ampleur et ses limites, le domaine, ou le territoire, où s’épanouit son invention créatrice.
Belleza (en verso), 1923, appartient à l’époque du « spiritualisme symboliste », comme l’appelait aussi Jiménez.
Le bien, le beau, le vrai : cette triade informe la poétique de Juan Ramón Jiménez. « Pour moi, disait-il, la poésie est mon incorporation à la vérité par la beauté, ou à la vérité dans la beauté, et en dernier lieu de mon dieu possible par la succession de la beauté. Il est clair que cette vocation suppose un effort total de tout l’être ».
La beauté, dans sa valeur ontologique, est promesse de l’avènement du sujet à lui-même, dans l’éternité de l’instant :
Qu’il est beau de vivre ainsi toujours debout,
– beauté ! –,
pour le repos éternel d’un instant !
Chez ce poète à la sensibilité exacerbée, la beauté n’est jamais un concept abstrait. Il la reconnaît aussi bien dans les choses, les êtres ou la nature, que dans les créations de l’art.
Presse et librairies
En France, on ne connaît pas le poète espagnol Juan Ramón Jiménez. C’est comme si Verlaine était ignoré en Espagne.
Philippe Lançon, Libération, 2 juin 2005