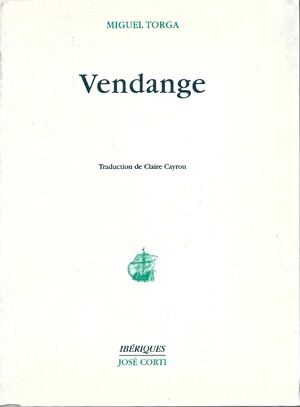Vendange
Traduction de Claire Cayron.
« Senhor Angelo connaissait le théâtre humain et ses marionnettes. Le versant qui s’élevait en face lui fournissait l’image d’une scène gigantesque où se jouait la comédie de la vie. Tout en bas, la pauvreté piétinée et affamée ; au milieu (ceux) qui s’étaient élevés avec le temps, obscènes d’impatience et d’insensibilité ; en haut, l’élite dont il faisait partie, jouissant des derniers privilèges hérités. Irréconciliables, les trois mondes se haïssaient et se combattaient. Celui d’en bas avait la raison du nombre et l’arme puissante du travail ; celui du milieu, plastique et tentaculaire, traçait son chemin à coups d’audace et de ténacité ; celui d’en haut brandissait les armes immaculées de la culture et du goût en se prévalant de la légitimité de privilèges ancestraux. Seul le premier avait besoin d’une victoire totale et retentissante. Parce qu’il sortait des brumes, il voulait la clarté totale. Aux autres, le maintien de l’équilibre suffisait (…). Le combat des trois ennemis aurait-il une fin prochaine ? ».
Nous sommes dans les Terres Chaudes du Douro, la région où s’élabore le porto, le temps d’une récolte. Si les trois forces en présence se combattent, elles-mêmes sont parcourues par toutes les tensions humaines, dans l’ordre de la sensibilité, de l’affectivité et de la sexualité. Certains gardent leur dignité, d’autres la perdent, d’autres encore se mettent en chemin pour la trouver.
On peut s’étonner que ce roman subversif, écrit au début des années 40 et publié pour la première fois en 1945, n’ait pas été saisi par la censure, comme le Quatrième Jour de La Création du monde l’avait été en 1939 et les Contes de la Montagne en 1941. Serait-ce parce qu’il ne s’agit pas ici de subversion politique ou religieuse, mais de subversion sociale, et qu’il importait peu à « l’État Nouveau » salazariste qu’on mette en scène la lutte entre les grands, les gros et les petits ? Quoi qu’il en soit, en raison des saisies précédentes, l’urgence pèse sur ce livre, dont le style et le rythme sont marqués par la compulsion. Comme s’il devait être le dernier, tous les thèmes que développeront les nombreux ouvrages à venir se bousculent dans ce roman.
Claire Cayron
Presse et librairies
Comme dans les grands romans de Giono, Vendange ne raconte pas seulement l’histoire singulière d’un groupe de vendangeurs face aux maîtres. Au-delà de l’affrontement social, au-delà d’un récit violemment dénonciateur, Torga écrit une histoire plus vaste, plus poétique, qui se joue entre une terre, des bêtes, des plantes et des hommes. Dans ce pays de mélancolie et de brume, condamné à regarder au large de ses côtes immenses, s’écrit une page d’éternité. Les hommes passent avec leurs amours contingentes, leurs peines, leurs désirs de dominer le monde. Restent les paysages et cette terre que d’aucuns travaillent de leurs mains, transforment, et dont la géographie peu à peu finit par raconter l’histoire.
Michèle Gazier, Vignes à haute tension, Télérama, 23 juin 1999Un roman puissant et sombre, ancré dans la région du Douro, non loin de la terre d’origine de Torga : Tras-os-Montes, l’« au-delà des montagnes », cette province montagneuse aride et pauvre du nord du Portugal pourr laquelle Torga toujours conserva un attachement viscéral.
Nathalie Crom, La Croix, 1er juillet 1999