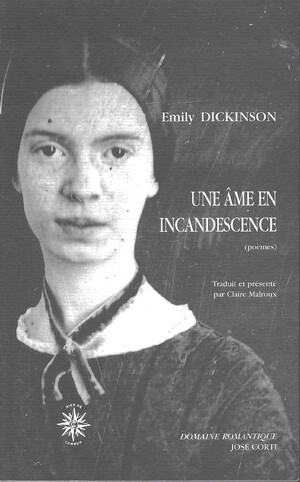Une âme en incandescence
Traduction de Claire Malroux.
“Oses-tu voir une âme en incandescence ?”
Cette question au ton dramatique, impérieux, provocant, Emily Dickinson l’adresse à quiconque se penche sur son œuvre. La réponse, empreinte d’un mystérieux effroi, elle la fournit elle-même, à la fois actrice et témoin, avec cette capacité de dédoublement qu’elle possède à l’extrême. Ordre est donné au curieux de se blottir sur le seuil, comme si la forge intérieure était un sanctuaire interdit, le lieu d’une activité sacrée transcendant celle du Dieu du Feu de la mythologie antique, Héphaïstos ou Vulcain. D’emblée une distance est posée entre le poète et le lecteur ignorant ou incrédule qui voudrait saisir le secret de la création.
Une “âme en incandescence” ne s’explique pas ni ne s’analyse ; elle mérite le silence de la contemplation, un respect religieux. Peut-être faut-il voir dans ce mouvement d’orgueil l’effet d’une frustration ressentie à l’orée d’une carrière littéraire manquée mais dont on peut à bon droit se demander si, les circonstances ayant été autres, elle ne se serait pas épanouie tout comme celle de ses contemporains, Hawthorne, Melville, Poe ou Whitman.
Le mot d’“incandescence”, en revanche, qualifie avec la plus grande justesse l’état de surexcitation poétique qui devait être celui d’Emily Dickinson en 1861, 1862 et 1863. Ces trois années marquent un sommet, l’aboutissement d’une longue secousse tellurique, le déferlement d’une lame de fond dont les signes avant-coureurs étaient apparus près d’une décennie auparavant.
Notre connaissance d’Emily Dickinson demeure encore aujourd’hui fragmentaire, car elle repose sur des choix de poèmes. De tels choix, même s’ils se veulent aussi représentatifs que possible, risquent à la longue de brouiller la réalité profonde du poète. Une autre démarche, face à la diversité des approches à laisser émerger, comme d’elle-même, sa figure unique.
D’où le soucis de présenter ici au moins la partie la plus essentielle de son œuvre, par la traduction de la quasi intégralité des poèmes de ces fameuses trois années. Les textes figurent dans l’ordre où Emily Dickinson les a elle-même transcrits dans ses “cahiers cousus”. L’ouvrage vise ainsi à la fois à restituer le tissu interstitiel de la poésie et une architecture altérée par des éditions successives.
Ces Cahiers proposent un autre mode de lecture. Ils invitent à saisir la poésie dans l’abrupt et non dans l’horizontalité du temps, à renoncer aux catégories habituelles de l’intellect, à traverser l’écorce de la chose poétique pour se rapprocher du feu central.
Claire Malroux
Presse et librairies
Lire la poésie d’Emily Dickinson relève d’une expérience existentielle autant que littéraire.
Stéphane Bouquet, Libération, 9 avril 1998