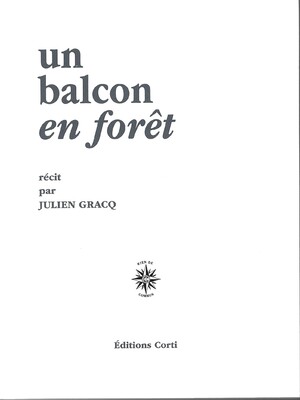Un Balcon en forêt
1939, ce sont les premiers mois de ce que l’on appellera la drôle de guerre. Période de suspens, d’attente particulièrement dans les Ardennes où l’aspirant Grange a pour mission d’arrêter les blindés allemands si une attaque se produisait. À la fois île déserte et avant-poste sur le front de la Meuse où montent des signes inquiétants.
Presse et librairies
On nous a changé notre Gracq du Rivage des Syrtes.
L’ExpressLa critique est un gros chat : pas méchant, mais un peu bougon, le chat déteste être troublé dans ses habitudes. S’il dort dans le fauteuil à gauche de la cheminée, ne le dérangez pas, asseyez-vous à droite. De même, la critique préfère qu’un auteur ne s’écarte pas trop du chemin qu’il s’est tracé. Le Château d’Argol, Le Rivage des Syrtes étaient des romans poétiques quelque peu surréalistes dans l’expression. Le Roi pêcheur était une pièce symbolique ; qu’est-ce donc maintenant que ce Balcon en forêt où l’on nous raconte la vie de l’aspirant Grange dans les Ardennes durant le long hiver de la drôle de guerre et où la brève tragédie de l’offensive allemande forme le dénouement ?
Jean Mistler, L’Aurore, 7 octobre 1958Grâce à Julien Gracq, grâce à cette optique extra-ordinaire d’un surréaliste sur la marche ardennaise, l’on n’est pas près d’oublier « le vaste horizon de mer des forêts de Belgique » qui déroulent leurs vagues vers Bouillon, Florenville, Marche et Spa. Vrai, si Un balcon en forêt s’achève sur du nihilisme, sur une sorte de désespoir tranquille, nous garderons plutôt, pour notre part, dans nos yeux et dans nos âmes toute l’immensité de l’Ardenne qui respire « dans cette clairière de fantômes comme le cœur d’une forêt magique palpite autour de sa fontaine », toute cette forêt, oui, « plus ouverte que les rêves de la nuit » …
Le CourrierSi j’ai des objections à y présenter (…) elles portent sur le sujet, et une certaine ambiguïté d’intentions. Julien Gracq nous renvoie à dix-huit ans en arrière, ce qui est un recul trop lointain ou trop proche. Les mois hideux de la « drôle de guerre », où s’alanguit l’instinct guerrier de nos armées, dans l’attente et dans l’inaction. Ce roman tient presque du pamphlet.
Robert Kemp, Les Nouvelles Littéraires, 25 septembre 1958Car ce qui emporte d’un pas sûr et lent, ce beau livre verdoyant, c’est le rythme même des saisons sylvestres, c’est l’accumulation subtile de petits détails exacts, de notations précises sur la vie naturelle, les arbres, les journées en forêt. Les Robinsons de la ligne Maginot perdus dans la belle nature et leur mauvais rêve, attendent, avec une sorte de délicieuse et trouble angoisse ce qui va les arracher à l’une et à l’autre.
Claude Roy, Libération