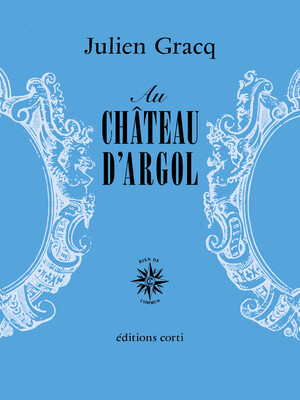Au château d’Argol
Au château d’Argol est le premier roman de Julien Gracq, le premier roman surréaliste tel qu’André Breton le rêvait. Les sens irrigués par les lieux et les espaces sont l’image la plus exacte des relations entre les êtres, Albert le maître d’Argol, Herminien son ami, son complice, son ange noir, et Heide, la femme, le corps. Tout autour, sombre, impénétrable, la forêt. Tout près, l’océan.
« Et si ce mince récit pouvait passer pour n’être qu’une version démoniaque – et par là parfaitement autorisée – du chef-d’œuvre [Julien Gracq évoque Parsifal de Wagner], on pourrait espérer que de cela seul jaillît quelque lumière même pour les yeux qui ne veulent pas encore voir. Les circonstances communément entendues comme scabreuses qui entourent l’action de cette nouvelle ne lui sont nullement essentielles. […] Puissent ici être mobilisées les puissantes merveilles des Mystères d’Udolphe, du Château d’Otrante, et de la Maison Usher pour communiquer à ces faibles syllabes un peu de la force d’envoûtement qu’ont gardées leurs chaînes, leurs fantômes, et leurs cercueils : l’auteur ne fera que leur rendre un hommage à dessein explicite pour l’enchantement qu’elles ont toujours inépuisablement versé sur lui. »
Julien Gracq, Avis au lecteur
Première parution en 1938.
Presse et librairies
La ligne du récit est extrêmement simple. Son sujet ne se résume ni par une intrigue, ni par une action mais par une situation : deux hommes et une femme que le « drame de la fascination » réunit et retient dans un château isolé. Le roman commence par un voyage et donc par une rupture. Il s’établit dans une demeure perdue, coupée du monde : le manoir d’Argol, et dans un espace temporel en marge : les vacances.
Bernhild Boie, Julien Gracq, Œuvres complètes t. I, La PléiadeAu château d’Argol est le début d’un jeune écrivain particulièrement bien doué. Il habite loin de Paris où il ne connaît personne et vit visiblement dans un monde un peu livresque ; mais peut-être faut-il commencer ainsi sa carrière littéraire. ( …) M. Julien Gracq est visiblement influencé par le surréalisme, mais il en a dépassé le premier stade. Il est de ceux à qui cette esthétique a permis d’entrevoir une forme nouvelle du roman, et même des lettres en général. Il se peut en effet, que le surréalisme nous mène à une forme inconnue de la fiction, à la fois plus épique et plus féerique.
Edmond Jaloux, Les Nouvelles littéraires, 4 mars 1939Il ne faut pas conseiller la lecture de ce livre à ceux qui ne sentent pas en eux cette présence affamée, décisive et tenaillante que M. Edmond Jaloux a ainsi définie : « le démon intérieur est toujours quelque chose qui se refuse en même temps qu’il vous assaille. Quelque chose qui se dérobe au moment même où il vous appelle. Quelque chose qui vous force à parler et qui ne veut pas être dit ». Ce démon, qui n’est autre que l’être soumis à sa dialectique de ténèbres et de lucidité, habite avec une épuisante actualité, le roman de M. Julien Gracq. Dès la préface, se pose le problème de la conscience dans le mystère. (…) Cette unité fulgurante et foudroyée, inconcevable pour une imagination privée d’aliments réels, mais évidente pour ceux qui sentent leurs rêves comme une vie vraiment vécue ; cette identité des états de la nature et d’une pensée à son point extrême de détachement ; cette attention, en un mot, c’est cela qui mène l’étonnante prose de M. Julien Gracq par les routes brûlantes ou glacées, hasardeuses ou volontaires de l’hallucination. Parsifal, mais en version démoniaque, le double héros renaît et disparaît dans la blessure inépuisable ; blessure ouverte de l’existence, où saignent la forêt, le ciel, la lance, l’orage, la nuit, l’esprit et le désir ; blessure au fond de laquelle, comme deux bouches dans leur baiser, la mort étreint silencieusement la vie.
Y. Delétang-Tardif, Vendémiaire, 29 mars 1939