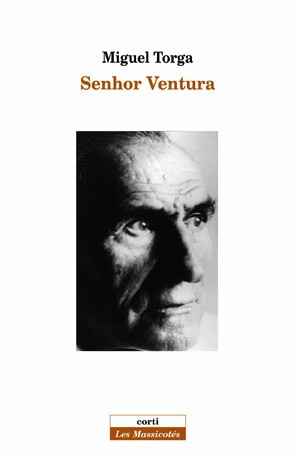Senhor Ventura
Traduit du portugais par Claire Cayron
Senhor Ventura de Miguel Torga est un mélange de pícaro et de Don Quichotte, mais à la portugaise, c’est-à-dire dans la migration et l’écartèlement : aventurier en Orient et redresseur de torts à Penedono (Alentejo), sensuel et sentimental, trafiquant et honnête homme, cupide et généreux, solitaire et solidaire, soumis à ses passions et révolté contre la tyrannie du milieu. À ses côtés chemine un temps, en camion Ford, un Senhor Pereira (Sancho), qui lui révèle “l’intime et confiante connivence” de l’amitié.
On peut lire, dans Senhor Ventura, une alternative utopique : d’une part le monde de la corruption, ici figuré par l’Orient où le Portugal déploya sa vénalité mercantile ; et d’autre part le monde idéal de la terre-mère. Mais l’utopie se heurte constamment au réel, un réel majuscule qui finalement l’emporte : “Le Sexe, j’y insiste. Et même flanqué de Lawrence et de Freud, j’ajoute : la perdition.”
Par les aventures, les personnages et le ton, le découpage et la rapidité, ce curieux récit en spirale tient à la fois du roman picaresque, du feuilleton et du synopsis. Il a été publié pour la première fois en 1943. Miguel Torga avait alors 36 ans. Senhor Ventura porte les mêmes croix que son auteur : blessures de l’émigration et de l’humiliation, tension entre le déracinement et l’enracinement, entre le déterminisme et l’ardente nécessité de l’entraver – qui trouvera dans les Poèmes Ibériques une expression triomphante : “Tous nous faisons notre destin.”
Presse et librairies
Ce récit vif et enlevé raconte les tribulations d’un jeune paysan de l’Alentejo entre la Chine, où il va chercher la fortune et l’amour – il n’y trouve que le contraire de l’une et de l’autre – et son village de Penedono, où il tentera de se retrouver. Mais derrière ces épisodes, derrière « la soumission des instincts et des sens aux voies de l’aventure », c’est la figure emblématique de l’Emigrant, que détaille Torga, c’est la fable éternelle de l’Exil et du Retour qu’il écrit, superbement.
Patrick Kéchichian, La Terre de Torga, La Monde, 10 avril 1992(…) L’écriture est sobre et savoureuse, les séquences se succèdent à un rythme rapide, l’auteur, omniscient, médite sur le carctère et le destin de ses héros, symboles d’un pays qui hésite entre la terre et la mer, jadis ouvert sur le monde et conquérant, aujourd’hui prostré.
Juan Marey, Révolution, 30 avril 1992Depuis la Pérégrination de Fernao Mendes Pinto et les Lusiades de Luis de Camoes, classiques fondateurs de la littérature portugaise, les récits n’ont pas manqué dans ce pays, qui racontent « des existence frappées d’ubiquité, divisées, perturbées… ». Senhor Ventura s’inscrit dans cette lignée. Dès le début de cette fable menée à un train d’enfer (on pense au Mandarain d’Eça de Queiroz), Miguel Torga affirme qu’il met dans son héros « la réalité de ce qu’[il est] et la nostalgie de ce qu’[il aurait] pu être. »
Antoine de Gaudemar, Libération, 30 janvier 1992