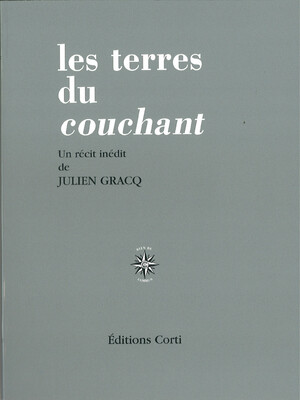Les Terres du couchant
En 1953 Julien Gracq entreprend un roman qui se situe comme Le Rivage des Syrtes dans cette zone rêveuse où Histoire et Mythe, imaginaire collectif et destins individuels s’entrelacent. Il y travaille pendant trois étés. Travail lent, hésitant, suspendu en 1956 pour écrire Un balcon en forêt et dont témoignent les quelque 500 pages manuscrites du fonds Gracq à la Bibliothèque Nationale.
Le texte que nous publions est très proche d’une version définitive, même si aux yeux de l’auteur il n’a pas trouvé sa forme dernière. On est toujours tenté de présenter la publication posthume d’une œuvre comme une découverte sensationnelle, qui change l’image établie d’un écrivain. Pourtant, ce récit ne bouleverse pas la vision que nous pouvons avoir de l’œuvre de Gracq. Mais il la complète d’une manière significative et nécessaire. Il conduit à une compréhension plus intime, plus précise, de l’écrivain, des chemins qu’il emprunte, de son regard sur le monde et de son imaginaire. Ce constat, suffisant sans doute pour présenter ce texte au lecteur, n’est pas pourtant la raison première de sa publication. Ce qui compte le plus, c’est la singularité de ce récit qui trouve ses péripéties dans les incidents de la route et dont la narration se confond tout naturellement avec la vie des chemins et des saisons. Ce manuscrit trouvé dans une malle, et qui pour Gracq était une étape, est pour le lecteur un de ces beaux cadeaux que l’histoire littéraire offre parfois à la postérité.
Presse et librairies
Arrêtez tout, lisez Julien Gracq !
Guy Konopnicki, Marianne, 2 octobre 2014Une prose si belle, si attentive aux phénomènes du corps et de la nature, qu’on délaisse volontiers les péripéties d’un récit inachevé pour s’immerger dans cette coulée d’images somptueuses.
Bernard Fauconnier, Le Magazine littéraire n° 548, octobre 2014Ce livre est dans le droit fil du meilleur Gracq, tellement gracquien que les enchantés d’une écriture poétique aussi singulière y trouveront plus que leur compte.
Maurice Mourier, La Quinzaine littéraire, 1er au 15 novembre 2014Jamais le regard de Gracq n’avait eu cette acuité cosmique. Il se réfère à une terre immémoriale, lavée à neuf par une catastrophe décrite avec une vivacité féroce. Mais Gracq n’était pas fait pour l’hypotypose (la scène frappante). Après cette sortie aventureuse débouchant sur chairs et cadavres, il devait regagner sa patrie littéraire : le halo des mots. Allumer une mèche qui fasse grésiller le lexique de proche en proche, alors que se profile la guerre, seul champ de forces à même de mettre en tension une conscience et un paysage.
Antoine Perraud, La Croix, 9 octobre 2014Étrange pouvoir de l’inédit : celui d’être tout à fait neuf et de nous inviter, en même temps, à remonter le temps, à retrouver d’anciens plaisirs de lecture qu’on croyait ne pas pouvoir renouveler.
Éléonore Sulser, Le Temps, 4 octobre 2014Les Terres du couchant parcourt un thème récurrent de Gracq, le silence […].
Mathieu Lindon, Libération, 9 octobre 2014C’est un texte altier, superbement écrit, qui ravira tous les aficionados de Gracq.
J.-C. P., Livres Hebdo, 26 septembre 2014Une symphonie.
Thierry Cecille, Le Matricule des Anges n° 158, novembre-décembre 2014