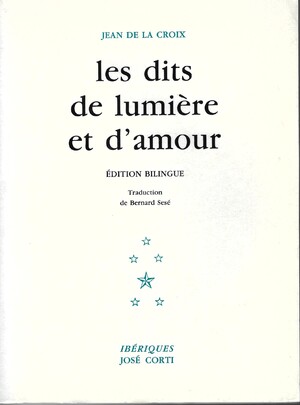Extrait de Saint Jean de la Croix, De la « Nuit Obscure » à la plus claire mystique, par Maria Zambrano (Sur, Buenos Aires, n°63, décembre 1939) :
Saint Jean de la Croix est issu de la vie de l’Espagne, de la vie de la Castille, mais sa transparente universalité est telle qu’il est difficile de s’en apercevoir. Il faut traverser la transparence de cette universalité pour parvenir à la véritable racine dont elle a dû sortir; il faut parcourir le chemin même qu’elle a dû parcourir en dépassant tout (« toute science transcendant ») pour saisir la nécessité qui demeure sous son vol de haute altitude, la nécessité de sa liberté, la substance où a dû s’allumer cette flamme qui paraît ensuite l’avoir entièrement consumée.
Et nous nous trouvons ainsi devant deux choses : le vol, le dépassement d’une créature au moyen de la mystique et de la poésie, et le fait que cette même créature, cette même mystique et cette même poésie nous servent de clé, de signe non équivoque de la substance qui l’a engendrée, de la vie qui l’obligea à voler si haut. (…)
Ce à quoi est parvenue, la mystique de saint Jean, dans toute sa pureté, est en partie négative : éliminer, effacer, séparer. L’ascétisme est renoncement. Mais bientôt nous sentons qu’il se passe quelque chose sous la transparence de sa prose si pure, quelque chose de cruel qui dénote une grande activité et qui rappelle, par analogie, un processus : l’âme s’est dévorée elle-même pour se transformer en autre chose. Ce que nous trouvons chez saint Jean n’est plus humain à proprement parler, et cependant cela se passe chez des hommes ; et c’est cela le phénomène de la mystique de saint Jean de la Croix dans sa plus grande pureté, et nous verrons comment la poésie s’unit à elle sans la détruire. Parce que la mystique se passe à l’intérieur de l’âme, à l’intérieur de ce qu’il y a de naturel en l’homme, en vertu de quelque chose qui n’est pas naturel ; en vertu d’autre chose qui est extérieur à l’âme, moins au sens strict où cela ne fait pas partie d’elle.
Ce qui palpite au fond de la mystique de la création de saint Jean, c’est une voracité qui nous a rappelé la chrysalide dévorant son cocon, mangeant son enveloppe ; faim d’exister, soif de vie. Voracité qui transposée sur le plan humain est amour, faim irrésistible d’exister, d’accéder à « une présence et une figure ». Ce désir inextinguible de présence et de figure manque dans le culte du néant de Miguel de Molinos, et chez lui la voracité n’est que l’amour de la mort, une tendance à la destruction finale, un dégoût mortel de l’existence. La destruction y est réellement destruction ; la chrysalide mange le cocon parce que le cocon, l’âme humaine, n’est pas en repos, parce qu’elle porte en elle le germe de sa transformation ; s’il n’en était ainsi, si la vie humaine pouvait s’arrêter à elle-même, le mystique du néant ne la dévorerait pas ; il y demeurerait comme dans son linceul.
La destruction que nous voyons chez saint Jean de la Croix est de plain-pied dans l’essence de la création. Création qui va même au-delà de la morale. La mystique du néant n’accède pas à la morale ; celle de saint Jean de la Croix la traverse, la consume, car, comme toute véritable création, elle ne peut se servir d’une mesure déjà forgée, d’un canon qui lui indique sa portée, qui la limite. La morale est la deuxième enveloppe, après l’enveloppe psychique, que la mystique de saint Jean dévore dans la voracité de son amour, puisque « tout ce qui se fait par amour se fait au-delà du bien et du mal », d’après Nietzsche, cet autre grand amoureux.
Extrait de « La Croix et la manière » par Gérard Dupuy, Libération, décembre 1991 :
Dans la nuit du 13 au 14 décembre 1591, un pauvre moine torturé de gangrène s’éteignait dans une sérénité parfaite au couvent des Carmes Déchaux de Ubeda. Son dernier souhait avait été exaucé – ses compagnons avaient accompagné les dernière minutes de ce qu’on n’ose appeler une agonie par la lecture à haute voix de passages du Cantique des Cantiques. C’est en poète que Jean de la Croix finissait d’habiter la terre.
Sa propre œuvre poétique, quelques dizaines de brefs couplets, recopiés par une poignée d’admirateurs(trices) passionné(e)s, n’avait encore pour lecteurs que quelques rares religieux(ses). On convient aujourd’hui de les compter parmi les joyaux de la littérature universelle. En savoir plus.