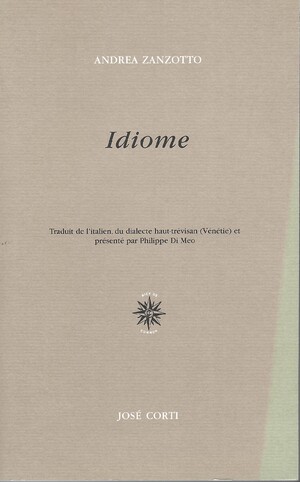Idiome
Traduit du dialecte haut-trévisan (Vénétie) et présenté par Philippe Di Meo
Idiome constitue le troisième volet de la trilogie du poète entamée avec Le Galaté au bois et continuée avec Phosphènes. Le premier plan s’articulait autour de l’opposition nature/culture à travers les métaphores de la forêt et des règles de bienséance posant du même coup un sud aux riches sédiments historiques ; le second reconduisait l’espace du dedans de tradition pétrarquiste assigné à un nord peu effleuré par l’histoire à travers les images du gel et de la liquéfaction.
Idiome, dernier segment du dessein trinitaire s’articule autour du bourg natal de l’auteur, Pieve di Soligo, et prend pour thème ce mouvement de longue durée qui édifie la langue entre érosion et germination, d’idioties (son niveau le plus bas) en idiomatisme (son niveau le plus haut). On peut entamer la lecture de l’ensemble par n’importe quel bout. Sans hiérarchie aucune, des poèmes écrits en italien et des poèmes en dialecte haut-trévisan se succèdent sur la page évoluant à des niveaux de littérarité différents : du plus humble au plus recherché. Il y est question des petits métiers d’autrefois, de la résistance aux troupes nazies, de personnages pittoresques, des attentats des années de plomb mais également des espaces sidéraux difficilement imaginables car plusieurs niveaux de réalité, attestés par différents niveaux de langages, se chevauchent. Entre personnification, et abstraction, le recueil fourmille, vibrionne de tableautins et de silhouettes contradictoires d’hier et d’aujourd’hui. Est ainsi décrit le mouvement destructeur et généalogique qui ensevelit et met bas les langues et langages de poncifs éculés en hapax hardis.
Presse et librairies
La tâche que Zanzotto assigne au poète est (…) ambitieuse et quelque peu sacrificielle, sinon mystique : se laisser traverser par la parole, et la sauver du bruit du monde et de la fossilisation des styles. Retrouvant la voix, la poésie se fait «désécriture», l’art subtil de redonner une chance à ce que les mondes puissent (re)commencer à s’écrire.
Jean-Baptiste Marongiu, Libération, 22 juin 2006« Coudre », « recoudre » sont les maîtres mots d’une œuvre qui, par ses sutures, suit toujours le bord des déchirures de l’espace, du temps et du corps qui les synthétise, dans un triple geste d’énonciation, d’apaisement et – semblable en cela au tissage/« détissage » de Pénélope – de conjuration du temps.
Renaud Ego, Le Monde, 7 juillet 2006(…) Être debout ne va pas de soi ; la poésie de Zanzotto est tout entière travaillée par la menace d’une « donnée déshumanisée qui assiège », et à laquelle il faut opposer une conscience active, une œuvre.
Marta Krol, Le Matricule des anges, juillet/août 2006L’idiome, ici, n’est pas tant langage commun qu’excès. Il se nourrit forcément de plus d’une langue et ne saurait se reconnaître dans aucune tonalité – que celle-ci prennent les formes de la tradition littéraire ou du dialecte. Paradoxalement, ce non-lieu qu’est devenu le poème s’enracine dans la réalité la plus concrète, celle qui la fait participer au dessin d’un paysage où la mémoire d’une communauté, magnifiquement exprimée à travers portraits et micro-histoires où l’on reconnaîtra autant d’allégories du « faire » poétique.
Quinzaine littéraire, juillet 2006, Gilles QuinsatSi le poète s’intéresse au langage enfantin, c’est parce que celui-ci est proche des origines mêmes de la langue : le conscient et l’inconscient, le signifié et le signifiant, les mots et les choses s’y entremêlent inextricablement. Cet amas indifférencié fascine Andrea Zanzotto : il y voit un espace de liberté qui s’oppose à la standardisation à laquelle nous condamne la communication de masse. Le dialecte, qui conserve en quelque sorte cette innocence première, joue pour lui un rôle analogue.
Marco Sabbatini, Le Temps, août 2006Comment raconter, témoigner du passé sans le trahir ? C’est la question que pose Idiome.
Julien Burri, 24 heures