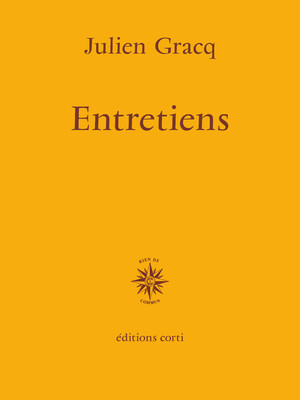Entretiens
Dix ans après la parution des Carnets du grand chemin, ce recueil d’entretiens avec Julien Gracq constitue un événement pour tous ceux qui, au fil des ans, ont suivi cet écrivain, un des rares contemporains accueillis par la Pléiade. Ces entretiens s’échelonnent sur plus de 30 ans puisque le premier avec J. L. de Rambures date de 1970 et le dernier, avec Bernhild Boie, de 2001. La variété des interlocuteurs comme celle des questions aboutit à un ensemble cohérent et complet – sinon exhaustif – où Julien Gracq s’exprime sur les sujets les plus divers :
– Réflexions sur ses méthodes de travail, les processus comme sa conception de l’écriture, des personnages, du récit, du temps romanesque, de la littérature ;
– Mises au point sur ses lectures, les influences d’autres écrivains, le rôle de sa formation de géographe et d’historien dans son travail d’écrivain, sa façon d’écrire, son esthétique, sa rencontre avec André Breton et le surréalisme ;
– Confirmations de ses « préférences » en matière littéraire, musicale, cinématographique, remarques sur sa formation personnelle et sur certains des grands événements du siècle comme sur les paysages, l’histoire, la politique, le rôle de la critique.
Que Julien Gracq se soit très rarement prêté au jeu de l’interview rend ce choix d’autant plus marquant, d’autant plus significatif.
J’écris de manière trop intermittente pour avoir une seule méthode de travail : il m’est arrivé plus d’une fois de passer une année et davantage sans m’y remettre.
Quand j’écris, je ne travaille pas avec régularité – pas d’heures fixes –, j’évite seulement le travail d’après dîner, qui entraîne immanquablement l’insomnie : je mets beaucoup de temps à me débarrasser l’esprit de mon écriture du jour. J’essaie simplement, si j’écris un récit ou un roman, de ne pas trop espacer les jours de travail, espacement qui rend plus difficile de reprendre le récit dans le ton exact où je l’ai laissé. Pratiquement, jamais plus de deux heures de travail dans une journée ; au-delà, j’ai besoin de sortir, d’aller me promener.
Si j’écris un texte court, dont l’écriture demande à être très surveillée, la marche sert d’ailleurs souvent à la mise au point presque mécanique d’une phrase qui ne m’a pas laissé satisfait : elle produit l’effet d’une espèce de blutage. La phrase qui reste dans mon souvenir à la fin de la promenade – tournée et retournée le long du chemin – s’est débarrassée souvent de son poids mort. En la comparant au retour avec celle que j’ai laissée écrite, je m’aperçois quelquefois qu’il s’est produit des élisions heureuses, un tassement, une sorte de nettoyage.
J’ai plutôt des habitudes et quelques exigences matérielles. Je n’écris pas dans le bruit, dans les lieux agités et remuants, jamais dehors. Pas d’allées et venues ; une pièce close et tranquille, la solitude ; j’écrirais difficilement ailleurs que devant une fenêtre, de préférence à la campagne, avec une vue étendue devant moi, un lointain.
Julien Gracq
Presse et librairies
Ces entretiens où il est si souvent ironique permettent aussi à Julien Gracq de s’expliquer un peu sur l’ironie, sans que cette ironie soit exclue des explications.
Mathieu Lindon, Libération, 17 janvier 2002Lectures, paysages, essence secrète de la littérature : voici de quoi sont faites ces conversations, dont le caractère très intime, lorsqu’il est là, lorsqu’on le ressent, de façon parfois prégnante, ne tient bien évidemment jamais à quelque confidence personnelle livrée comme par mégarde, mais bien au sentiment qu’on a, par instants, d’approcher, presque de toucher une clé de cette œuvre si teintée de secret – comme si la porte en demeurait entrebâillée, laissant flotter dans la pièce des zones d’ombre.
Nathalie Crom, La Croix, 24 janvier 2002Le style de Julien Gracq, à l’oral comme à l’écrit, dissipe le flou. Des formules claquent sans bruit de ferraille.
Marie-Laure Delorme, Le Journal du Dimanche, 27 janvier 2002Heureux les lecteurs qui emprunteront les beaux et grands chemins de ce livre !
Dominique Mondoloni, Var matin, 27 janvier 2001C’est un murmurant à la voix limpide et pure. C’est un ensorceleur au profit d’anonyme. C’est Julien Gracq comme s’il avait écrit lui-même ces pages.
Didier Pobel, Le Dauphiné, février 2002Le ton des réponses de Julien Gracq, par leur vigueur et par une simplicité qui fait échapper ces Entretiens aux conventions d’un genre mondain, invite chaque lecteur à puiser dans ses propres expériences de la lecture et de l’écriture.
Dominique Arot, Ressources n° 3, 2002Ces entretiens donnent à voir un écrivain soucieux de l’univers qui l’entoure, sensible à son temps, exigeant avec lui-même. Menant sa route sans jamais dévier. Un esprit libre.
Michèle Gazier, Télérama, 24 avril 2002Julien Gracq est un écrivain « secret », c’est-à-dire qu’il ne se montre pas, qu’il ne participe pas à des émissions de radio ou de télévision. C’est pourquoi ces entretiens sont précieux pour les lecteurs qui l’apprécient.
Paule Baltzinger, Bulletin du CPED, mai 2002Lire Julien Gracq, c’est toujours faire un long voyage. Ou plutôt une promenade. À l’étendue, où aime se dissoudre l’homme moderne, l’auteur des Carnets du Grand chemin préfère la profondeur, revenant sans cesse aux mêmes écrivains, aux mêmes souvenirs, aux mêmes désirs, aux mêmes questions. On sait où est son cœur : routes, cartes, confins, regards, reliefs, fleuves, histoires, lisières, frontières.
Sébastien Lapaque, Le Figaro Littéraire, 31 janvier 2002Julien Gracq s’est peu confié aux journalistes, encore moins aux caméras de télévision. Ce choix du retrait, de quelque manière qu’on l’interprète, il le partage avec un nombre réduit d’écrivains du XXe siècle. Cette attitude donne à sa parole, lorsqu’elle est enfin émise ou publiée, un poids auquel ne peut évidemment prétendre un discours multiplié et ininterrompu.
Patrick Kéchichian, Le Monde des Livres, 25 janvier 2002Gracq est à son mieux quand il parle de ce qu’il a connu. Et quand il en parle avec un décalage. Où Gracq se surpasse, c’est quand il parle des écrivains. Et des écrivains qu’il aime.
Bernard Frank, Le Nouvel Obs, 31 janvier 2002C’est la singularité d’une expérience qui se fait entendre et sa réfraction dans l’œuvre romanesque ou sa mise en forme fragmentaire dans une démarche d’essayiste qui, résolument, s’écarte des thèses ou théories critiques, cherche à demeurer au plus près des émotions, ce pour quoi les mots sont requis.
Anne Thébaud, La Quinzaine littéraire, 1/15 février 2002