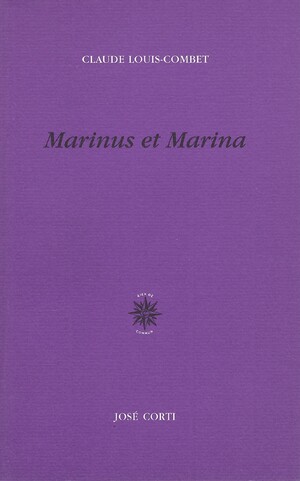Marinus et Marina
Dans la Bithynie chrétienne du Ve siècle, vivait une jeune vierge nommée Marina. À l’âge de quinze ans, elle entra, à la suite de son père, dans un monastère d’hommes où, ayant réussi à dissimuler son identité sexuelle, elle mena une existence de contemplation et de pénitence. Après sa mort, l’Église la canonisa sous le nom masculin de Marinus.
Traducteur et interprète de cette légende, le narrateur élabore le récit de son propre cheminement spirituel, à la fois contrepoint et écho de l’aventure intérieure de Marina. Le texte étranger – à sa langue, à sa culture et à sa foi – devient la lumière qui lui permet de déchiffrer peu à peu sa biographie, au cœur de laquelle la question de l’adhésion au masculin ou au féminin s’impose comme un problème limite qui ne débouche, ici, sur aucune voie de salut.
C.-L.-C.
Presse et librairies
Dans le champ si hanté de l’autobiographie, Claude Louis-Combet donne un grand coup d’envoi métaphysique, qui fait respirer plus largement le genre, en nous dérobant toute anecdote individuelle, toute confidence chuchotée. Ce souffle salubre, loin de délester le roman de ses attaches charnelles, lui redonne épaisseur et poids, par la vertu d’une écriture sensuelle et constamment lisible, qui utilise une impeccable syntaxe pour dire le désespoir.
Chantal Labre, Le Monde, 30 novembre 1979Ce n’est pas discréditer le travail de Claude Louis-Combet d’affirmer que tous ses récits forment un même texte, repris, remanié, qui pose de manière obsessionnelle la même question : qu’en est-il de l’identité ? Domine cette nostalgie de l’identité perdue. Le sujet est maintenant condamné à l’errance dans le désert, il oscille entre le féminin et le masculin, le bien et le mal, le péché et la grâce.
Alain Poirson, L’Humanité, novembre 1979L’écriture de Claude Louis-Combet résout toutes les contradictions par son mouvement de ressac incessant et riche. la vague par d’infimes changements, peu à peu accumulés, construit un monde en érodant le sens commun qu’elle mine et nous contrait à réexaminer.
Laurent Kovacs, La Nouvelle revue française, N°323, 1er décembre 1979Le seul roman vraiment nécessaire de la rentrée. Le seul qui descende aux sources charnelles du sacré pour inscrire sa présence même en ceux qui le nient.
Guy Le Clec’h, Le Figaro, 2 novembre 1979Ce que suit l’auteur, dans une écriture vaste, somptueuse, magistrale à saisir de son amplitude la totalité de l’existence, retenir le tissu des sensations les plus intimes dans leur luxuriance, accompagner, tout pittoresque écarté, la ligne d’un corps ou d’un paysage, c’est le cheminement de l’expérience intérieure depuis l’instant où, l’illusion mystique dissipée, il s’infléchit dans la quête désespérée, sortie de tout espoir, par-delà l’identité rompue, de l’unité originelle. Démarche toujours poursuivie mais sans aboutissement.
Claude Guerre, Libération-Champagne, 19 septembre 1979Ceci donne un roman assez « inactuel » où la mystique religieuse du sexe épouse la mystique religieuse avant de la relayer, et qui vient témoigner, dans son atemporalité, de la pérennité de fantasmes que chacun porte en lui, plus ou moins enfouis. Un roman d’où les préoccupations du monde semblent exclues, ou réduite à leur extrême vanité ; l’enceinte du monastère, la chambre, ou même le désert y occupant une place prépondérante.
Léa Chapignac, Rouge, 12 octobre 1979Le couple Marinus-Marina, c’est le narrateur lui-même, c’est-à-dire l’ambivalence incarnée, être double et unique, jour et nuit, lumière et ténèbres, à la fois hétérosexuel et homosexuel, athée et croyant, mystique et obscène (…). Pour tout dire, l’histoire sacralise le mythe de l’androgyne et montre que la quête de la contradiction peut conduire à l’unité la plus absolue.
Avec Marinus et Marina, Claude Louis-Combet pénètre (…) au cœur de l’écriture avec laquelle il tisse de longs fils multiples qui se croisent et s’entrecroisent sans cesse. Chez lui, le verbe est totalité et, à ce titre, il est sans doute un des rares écrivains actuels qui suive la voie qu’ouvrait Maurice Blanchot, au début des années 50.
Dans cette fable de l’androgynie, dans cette superbe célébration de la femme, à la fois amante et mère, de la féminité comme source et perdition, comme vie et mort, on reconnaît les obsessions de l’auteur du Voyage au centre de la ville.
Claude Bonnefoy, Les Nouvelles littéraires, N°270, 1/11/1979