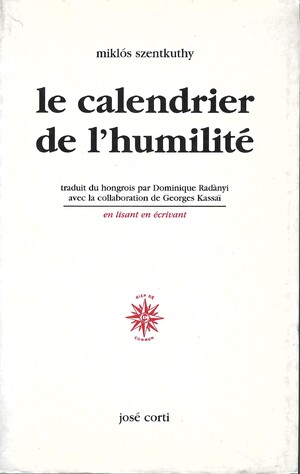Le Calendrier de l’humilité
Traduit du hongrois par Dominique Ràdanyi, avec la collaboration de Georges Kassaï.
Le Calendrier de l’humilité de Miklós Szentkuthy se rapproche de ses précédents fragments : Vers l’unique métaphore et En lisant Augustin. Comme eux, le texte témoigne d’une pensée en fusion, pensée d’« un ogre dévoreur de traités scolastiques, de saintes biographies, de sommes philosophiques et de magazines de mode.
"J’ai voulu tout voir, tout lire, tout penser, tout rêver, tout avaler. »
Le Calendrier s’en distingue aussi : la pensée y est plus cadrée, plus tournée vers l’ensemble de la création artistique (la peinture notamment, avec de longs essais sur Rembrandt, l’expressionnisme, l’impressionnisme) plus paradoxale aussi, plus provocante, comme si parfois l’ogre Szentkuthy se comportait en hussard pour convaincre le lecteur alors même qu’il doit parfois douter de la justesse de certaines positions.
e « grand désinvolte » est un être de dialogue dont la pensée avance en même temps qu’elle s’écrit ; sa faculté de persuasion, son style digressif inimitable suscitent, sinon toujours l’adhésion, toujours la remise en question d’idées toutes faites, quel que soit le sujet abordé – et on le sait, avec Szentkuthy, ils sont nombreux.
e titre lui-même, Le Calendrier de l’humilité est comme l’aveu ou la confession frivole du duel permanent entre orgueil et humilité.
Presse et librairies
« Le Calendrier de l’humilité » est fait d’une suite de réflexions qui pourraient constituer les notes d’un Journal que l’on ouvre au gré de ses curiosités (la table des matières est à elle seule un régal).
Pierre Deshusses, Le Monde, 5 février 1999