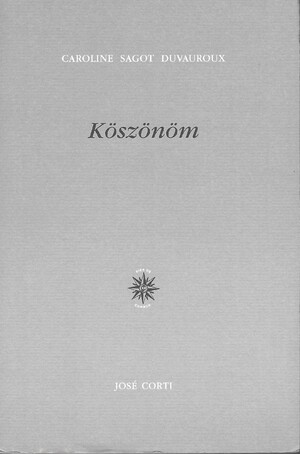Köszönöm
À Budapest, le jour du cinquantième anniversaire de l’insurrection, je ramasse le premier mot que j’entends : Köszönöm. Dans la plastique d’une langue et ses consonnes armées, se barricade : merci. Une intercession secrète. Il faudrait vivre jusqu’à la finale d’envol, jusqu’au délice d’un chant doux, mais j’en suis encore à l’attaque. Quelques semaines plus tard, à Besançon, un poète me montre une rondelle de métal qu’il garde en poche, première chose trouvée au sol, à Budapest. Kiskapu est gravé hâtivement dessus : petite porte. Kékséksa ? Une invitation au conte, c’est sûr. Mais le conte s’émiette dans la polyphonie, dévorée par sa propre faim et la mort de trop d’enfants sous la mitraille. Reste un brassage d’images et de mots, une langue magyare extrêmement étrangère, l’attente des métamorphoses.
Quand on a pas d’histoires, il faut un peu de géographie. Une partie plus ou moins autobiographique passe de la peinture à l’écriture, dit la métaphore à l’épreuve. Les lexiques jouent les personnages fictionnels du petit drame d’ici : la langue d’homme. Et la marche têtue sur la crête rocheuse syntaxe l’espoir fabuleux d’un poème premier. Mais il y a beaucoup d’épreuves jusqu’à l’estuaire de l’y. On se perdra d’ailleurs dans l’épreuve.
CSD
Presse et librairies
Köszönöm de Caroline Sagot Duvauroux affronte, pour la vaincre, la parole stérile, celle qui dresse sa flamme de bois mort au bord du précipice où retombent tous les mots moulinés à vide, pour personne, coquilles creuses, carapaces de tortue, les mots du ressassement, du ressentiment, les mots marchands qui s’écrasent par terre et roulent à l’égout avec les ordures ménagères.
Philippe Rahmy, remue.net, 3 décembre 2005 — Source