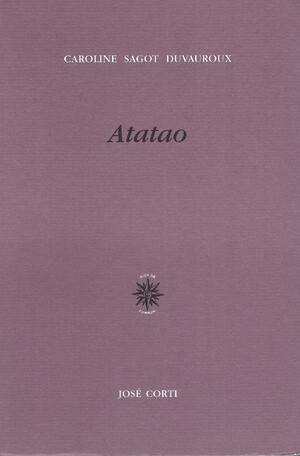Atatao
Où commence le voyage ?
Lundi. Une princesse à ma fenêtre soulève les montagnes. Chaque matin je la regarde clore le massif face au levant. Tout le jour le vent l’encoure, le ciel. Elle s’est couchée s’est endormie. Se souvenir ? Non. Regarde. Derrière à deux pas, c’est la mer. Ma tête comprend bien mais mon corps est plus simple et folâtre, voudrait toucher. Dors princesse. Je pars avant le jour.
Presse et librairies
La force et l’inouï de l’écriture de Caroline Sagot Duvauroux tiennent à la forme d’intimité que sa langue instaure avec un univers où « l’ombre est l’ange de la chose », où l’attente a parfois des allures de gloire, où la tendresse comme la plaie relève d’une forme de participation primitive au monde. (…) Une écriture dont la tension met en lumière les réalités inconnues dont nous sommes porteurs autant qu’elle dit la ruine du possible dans l’impossible. D’où ces mots toujours en passe de s’égarer et cette étrange sensation de déséquilibre toujours rattrapé in extremis. (…)
Richard Blin, Le Matricule des Anges n° 49, janvier 2004On en ressort hagard, surpris, violenté. Somme toute, c’est cela que nous cherchons dans le poème et c’est aussi ce que le poème n’ose plus nous offrir tant il s’est pris dans les pièges de la personnalité et du raisonnable, pire : de la littérature.
Marc Blanchet, Vient de paraître, décembre 2003Caroline Sagot Duvauroux nous fait don, avec Atatao, d’un poème qui renvoie la critique à sa propre insuffisance, en raison de l’écart irréductible marqué entre le parler du poème et la parole du poème.
Philippe Rahmy, remue.netAu langage retenu, à la parole rare et précieuse du poème, l’auteur oppose une parole déferlante et rocailleuse. Pas de recherche d’harmonies agréables à l’oreille, mais « le souffle rauque des bêtes en chasse » […]
Patrick Kéchichian, Le Monde, 13 février 2004La voix de la poétesse sait donner à son univers particulier une force d’évocation. La langue n’est pas sans rappeler une manière d’énergie rimbaldienne.
ARALD, février 2004Caroline Sagot Duvauroux invente une narration inconfortable et puissante, avec néologismes et dérivations, sectionnement de la syntaxe, ponctuation flottante (…). La langue de cet écrivain dit une violence, immémoriale, et la part féminine de sa douleur.
Glaudine Galea, La Marseillaise, 16 février 2004