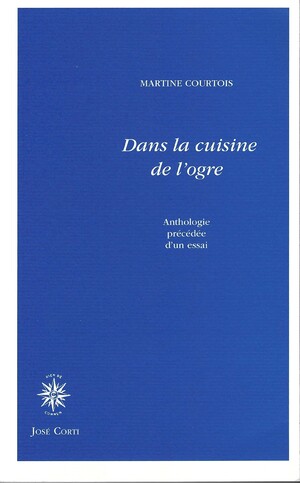Dans la cuisine de l’ogre
Dans la version de Perrault, lorsque le petit Poucet et ses frères arrivent à la maison éclairée, de l’autre côté de la forêt, la femme qui les accueille leur dit que c’est « la maison d’un ogre qui mange les petits enfants ». Le Poucet répond que de toute façon ce sont les loups de la forêt qui les mangeront : « Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit Monsieur qui nous mange ». Même en faisant la part de l’humour noir qui rend les contes de Perrault si délicieux pour les adultes, on peut se poser la question : en quoi est-il préférable d’être mangé par l’ogre plutôt que par le loup ?
On a tendance à croire que les ogres sont comme les loups, qu’ils dévorent les petits enfants tout crus et sans pain. Or, contrairement à ce stéréotype tenace, l’ogre des contes est un être de culture, qui connaît le feu, mange des nourritures cuisinées, et a des manières de table. Mais c’est justement cette part d’humanité qui le perdra : assez socialisé pour être dans le circuit de la communication, il ne l’est cependant pas assez pour la maîtriser, de sorte qu’il se fait duper par l’enfant malin. Le parleur est toujours plus fort que le mangeur.
Martine Courtois, à partir d’un corpus généreux, plus d’une vingtaine de contes, montre que la figure de l’ogre est beaucoup plus riche et complexe qu’on ne le croit généralement.
Presse et librairies
Il est toujours fascinant de lire des textes si proches, de les comparer, d’en observer les variations, les qualités, les dispositifs narratifs ou les motifs qui s’ordonnent autour d’une trame commune. Il se produit quelque chose de particulier dans cette forme de lecture compilée, on reconnaît des éléments, des traits qui structurent un même univers mental et fictionnel.
Hugo Pradelle, Entrevues, 2 avril 2020Le thème a une résonance universelle. Les aventures de Tom Pouce (Tom Thumb, Daumesdick) et de son cannibale, ogre, ogresse, sorcière, diable, géant, sont déclinées sur toute la planète, de Norvège au Mali, d’Argentine au Japon ; couvrant presque toute notre Histoire, de l’homérique Polyphème au tout début du siècle dernier, s’y essoufflant curieusement. Les ogres, les géants, d’une crédulité anormale, sont toujours dupés, ont toujours le dessous, dévorent leurs propres petits substitués, finissent brûlés sur un tas de fagots qu’ils ont échafaudé eux-mêmes, et dépouillés de leurs trésors.
Christophe Stolowicki, Dans la cuisine de l’ogre de Martine Courtois, 26 février 2020