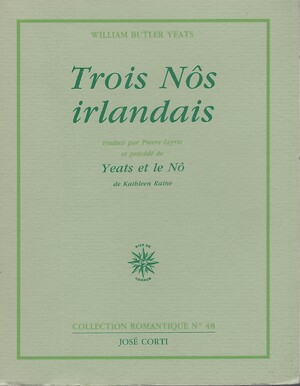Trois nôs irlandais
Traduit par Pierre Leyris.
Tel est le renom de Yeats poète (Prix Nobel en 1923) qu’on oublie souvent qu’il a été toute sa vie un homme de théâtre – militant, au début, car destiné à créer puis développer la conscience nationale ; puis “théâtre d’art” et non de “commerce”.
En fait, le théâtre poétique de Yeats reçut sa forme caractéristique et aboutie lorsqu’il découvrit par l’intermédiaire de son ami Ezra Pound, qui lui servait de secrétaire à temps partiel, le nô japonais – cadre parfaitement adéquat à une expression de l’âme où le naturel et le surnaturel se rejoignent dans une rencontre dramatique concentrant “Tous les éléments – costumes, mouvements, poésie et musique – pour produire une impression unique clarifiée”.
À la source du Faucon (1917), Ce que rêvent les os (1917), Purgatoire (1939), montrent bien que Yeats apprit du théâtre ce qui donne sa splendeur à toute sa poésie – écrire pour l’oreille et non pour l’œil : “Chaque pièce incarne une relation ou une émotion humaine fondamentale, et son charme poétique, ou sa poignante intensité, est porté à son plus haut degré par l’exclusion de tout élément obstructeur, comme ceux qu’exigeraient un réalisme mimétique ou un sensationnalisme vulgaire”. Pour Yeats, A la source du Faucon “prend place dans les profondeurs de l’âme, et l’un des antagonistes ne porte pas une forme comme en ce monde et ne parle pas une langue mortelle : c’est la lutte d’un rêve avec le monde”.
Les trois pièces sont précédées d’une importante préface de Kathleen Raine sur Yeats et le Nô, traduite elle aussi par Pierre Leyris.