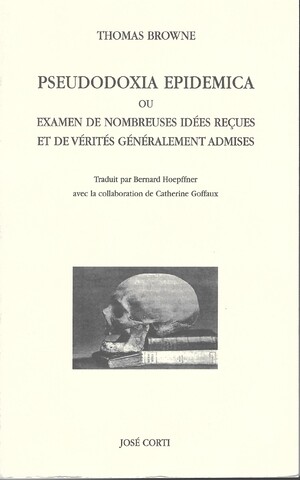Pseudodoxia Epidemica
Traduit de l'anglais par Bernard Hoepffner avec la collaboration de Catherine Goffaux
Après avoir donné en 2000 une traduction complète de la monumentale Anatomie de la Mélancolie, Bernard Hoepffner s’est attaqué à l’autre monument anglais de cette époque, Thomas Browne (1605-1687), dont Pseudodoxia Epidemica n’avait jamais été traduit intégralement en français.
Browne analyse les causes des croyances populaires telles que : les insuffisances de la nature humaine, la facilité à se tromper, les déductions fausses, le respect aveugle de l’autorité, la crédulité, l’influence du diable.
Il y a, dans la méthode employée par Browne, une bonhomie dans l’ironie, qui se teinte d’étrangetés et se tient avec une certaine complaisance entre l’ingéniosité et le savoir.
Son immense mérite, bien avant Flaubert et son célèbre dictionnaire « des idées reçues » est de ne pas accepter comme argent comptant ce que chacun accepte et colporte sans se poser la question de la justesse. Il passe au crible de son esprit critique les « idées reçues » comme « les idées généralement admises » et les soumet à l’expérimentation en se réservant le droit d’être incrédule.
Les 7 livres qui forment le volume lui permettent ainsi avec sa rhétorique implacable de se déplacer du règne animal (« De l’autruche à la vipère en passant par le phénix ») aux croyances religieuses (« D’Ève à Mathusalem ») ou aux idées reçues concernant l’homme (« Des Juifs aux Nègres ou aux Gitans ») ou aux croyances et aux dogmes dits « scientifiques » (« De la pierre d’aimant aux corps électriques ou à l’origine du monde »).
Browne, écrivain et médecin, a séduit ses contemporains, et continue de nous séduire, tout d’abord par sa personnalité – Montaigne anglais –, sa sincérité, son humour, son humilité, sa tolérance. Browne reste toujours l’un des grands artistes de la prose anglaise, par son goût de l’aphorisme, de la formule imagée, du paradoxe.
Presse et librairies
Le grand œuvre d’un incroyable styliste doublé d’un homme de science, né à Londres en 1605, tout nouvellement traduit.
Jean-Didier Wagneur, Libération, 8 juillet 2004Pour l’écrivain anglais du XVIIe siècle, admiré notamment de Coleridge, de Larbaud, de Borges, le monde est un livre sans fin.
Michel Crépu, La Croix, 15 juillet 2004