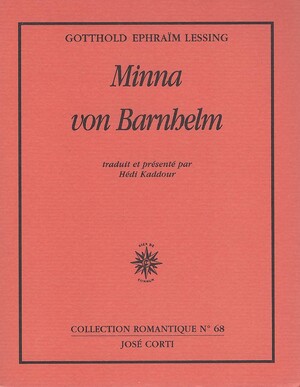Minna von Bernhelm
Traduction de Hédi Kaddour.
La représentation de Nathan le Sage à Avignon et à la Comédie française, marque bien l’actualité et l’intemporalité de Lessing. La première grande comédie de la littérature allemande s’ouvre sur le mot canaille et s’achève sur le mot veuve. Son argument est apparemment simple : pendant la guerre de Sept ans, un officier de l’armée prussienne, le major Tellheim, chargé de lever la contribution de guerre en pays saxon, en a généreusement avancé une partie. Ce geste a provoqué l’admiration d’une jeune fille de la noblesse locale, Minna von Barnhelm, qui a conquis Tellheim. À la fin de la guerre, l’administration du roi de Prusse refuse de reconnaître la créance du major. Congédié, déshonoré, mal remis d’une blessure au bras droit, Tellheim renonce à se marier et part vivre à Berlin. Les cinq actes mettent en scène l’infortune de Tellheim, sa misanthropie, le dévouement de ses amis, et les ruses déployées par la jeune fille pour reprendre possession de son fiancé récalcitrant. Ce qui fait le succès de Minna, c’est la force de son épure, le rythme de sa progression, la montée d’une ironie qui, bien au-delà de l’habituel châtiment des extravagances, prend acte de l’étrangeté des êtres et de la drôlerie du monde. Si ces personnages semblent parfois multiplier les obstacles qui les séparent du plaisir, un mot revient pourtant sans cesse dans leurs répliques, au sein d’un espace qui n’est jamais que celui d’une halte provisoire : le mot geschwind, “vite”. Et c’est sans doute aussi pour éviter que toute cette humanité ne lui file entre les doigts à grande vitesse, que Lessing installe au cœur de sa pièce un suspens dans le suspens, une comédie de la comédie, qui exerce sur l’ensemble la force centripète d’une ruse un peu perverse : imaginons Célimène ayant envie de retenir Alceste en faisant semblant de devenir à son tour victime et misanthrope, et prenant goût, en cours de route, au plaisir de la vengeance.