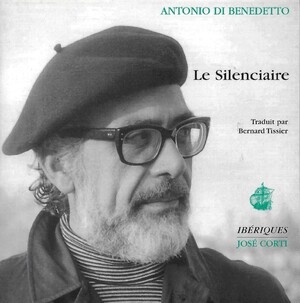Le Silenciaire
Traduction de Bernard Tissier.
« “Être dans le bruit”. Telle est la consigne. […] “Le monde sera bruit ou ne sera pas" », dénonce le narrateur-sans-nom, le silenciaire du roman. Du bruit, il dit encore qu’il asservit, qu’il corrompt l’être, qu’il est un instrument-de-non-laisser-être. Entre un monde voué au bruit et le protagoniste, le conflit est donc irréductible.
Fuyant les bruits de la ville qui le persécutent jusque dans sa chambre, le narrateur-sans nom entraîne sa mère et son épouse dans la vaine et interminable quête d’un lieu inaccessible au son. Il a beau affirmer qu’à l’inverse de son grotesque et tragique ami Besarión il tient en bride aspirations et imaginations, qu’il s’acquitte des devoirs du foyer et du bureau, peu à peu les nœuds qui le rattachent au quotidien se défont. Le champ de sa conscience tend à se rétrécir jusqu’à ne plus laisser entrer – paradoxalement – que ce dont il a une crainte obsessionnelle, à savoir les bruits. Enfermée dans une perception monomaniaque de la réalité, s’égarant dans des ratiocinations compulsives, sa raison s’altère et chancelle. Cependant, pour malade qu’elle soit, la conscience du narrateur-sans-nom reste une conscience rebelle aux prises – et en prise – avec le monde.
Pour évoquer la longue chute de son triste héros, Benedetto bannit les artifices rhétoriques et les discours explicatifs ; il use d’une langue sobre, ne s’attachant qu’à l’essentiel, et d’une efficacité étonnante. Son écriture laconique, mordante, incisive, et qui ignore superbement les transitions de la narration traditionnelle, est par ailleurs d’une grande souplesse. Car la sobriété du style n’est point chétiveté ; celui-ci est au contraire riche de nuances et se plie à toutes sortes de registres : familier, soutenu, descriptif, réflexif, voire, lyrique.
Presse et librairies
Le silenciaire tentera en vain de se murer dans soi grâce à des boules de cire dans les oreilles ou en avalant un sédatif qui le fait dormir dix-neuf heures de suite. « Le bruit ne me permet pas d’exister » explique-t-il à son ami Besarion. Mais le bruit le pousse à tenter de mettre le feu au quartier. Il se retrouvera en prison pour avoir voulu faire silence en quelque sorte, et de sa cellule il en éprouve à nouveau l’impossibilité ; tiré d’un songe par un bourdonnement dont il découvre soudain l’origine : « la scie des condamnés méritants qui travaillent dans l’atelier par autorisation spéciale et en échange d’un salaire, jusqu’à trois heures du matin ». Une image de l’humaine condition peut-être. L’humour de l’auteur cependant, son goût de l’incongruité, du rebondissement sinistre ou cocasse nous tiennent en haleine entre le rire et l’angoisse tout au long de la fable.
Jacques Fressard, La Quinzaine littéraire, 1er au 15 mars 2010On lit un agaçant mais fascinant petit précis de promiscuité et de la psychopathie ordinaires, le texte fonctionnant comme un délicat appareil enregistreur des troubles imperceptibles. Dans le monde de notre personnage, dont les frontières progressivement et dangereusement s’amenuisent, chaque événement (la chute d’une pédale de piano, des pierres contre le portail, la musique d’une radio) entraîne une reconfiguration intégrale de ce monde. C’est la chronique d’une défaite annoncée et d’un retournement assuré : le gêné deviendra « l’ennemi du progrès » et l’empêcheur de respirer en rond, disant à sa femme « Ne me fournis pas de matière à penser. Les pensées m’empêchent de dormir ». Celui qui, se détournant peu à peu de la vie et de son projet d’être écrivain, se retranche dans sa petite dictature intérieure, devient l’incendiaire du bruit…
Chloé Brendlé, Le Matricule des Anges n° 111, mars 2010