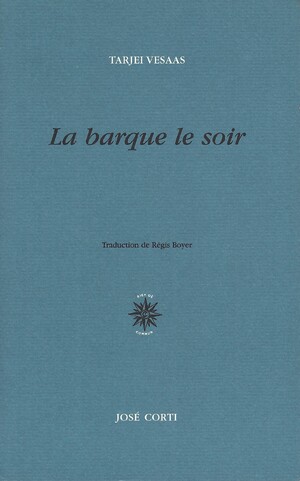La barque le soir
Traduit du néo-norvégien par Régis Boyer
Dans l’œuvre de Tarjei Vesaas, La barque le soir, publiée en 1968 et curieusement restée inédite en français est une œuvre fondamentale, crépusculaire. Appelée « roman » par son auteur, il s’agit plutôt d’amples réminiscence poétiques semi-autobiographiques. Il révise les thèmes qui ont accompagnés sa vie de créateur : l’effroi face à l’invisible, la condition spirituelle de l’homme, tandis qu’il brosse son propre portrait psychologique, de sa prise de conscience que l’homme est seul jusqu’à l’acceptation finale de la mort. Mais Vesaas n’est pas un auteur abstrait, fidèle à ses origines, il sait rendre présentes les choses les plus essentielles, les plus élémentaires : du pas d’un cheval dans la neige jusqu’aux variations infinies de la lumière.
« J’ai voulu traduire ce texte passionnant de Tarjei Vesaas qui, pour des raisons étranges, n’avait jamais vu le jour en français bien que presque tout le reste de l’oeuvre ait été traduit - parce qu’il résume à la fois l’inspiration du grand Norvégien et, en un sens, celle de son pays. Dernière œuvre de Vesaas, ce livre est à la fois une manière d’autobiographie pudique, faite d’allusions et de souvenirs vivifiés par une mémoire plus sentimentale que factuelle, un roman car les divers épisodes s’enchaînent de manière à constituer un tout cohérent où l’essentiel n’est jamais dit, et un poème de ce spécialiste qui a dit un jour, formule qui exprime l’essence même de son inspiration : "À qui parlons-nous lorsque nous nous taisons ? » La danse des grues, la première rencontre des amants, les merveilles de la nature lors de la fonte des neiges, les angoisses du petit garçon en face des difficultés de compréhension d’un père rude et d’une mère douce, voilà, entre bien d’autres, les échappées que propose à notre rêverie celui qui, sans conteste, compte parmi les deux ou trois grands écrivains de la Scandinavie actuelle.«
Régis Boyer, dédicace pour Radio France
Presse et librairies
Plus subjectif que ses autres livres, La barque le soir illustre avec une rare densité les talents de Vesaas, sa capacité d’évoluer « du rêve au réel, en passant par le symbole et l’allégorie, sans qu’il soit jamais possible de séparer l’un de l’autre ».
C. G. BjurströmOn n’est ni dans le réalisme, ni dans le fantastique, dans un entre-deux plutôt, qui consiste en la perception terriblement aiguisée du réel que possède l’écrivain et que savent traduire ses mots limpides, sa phrase lumineuse attaché à approcher au plus près l’ineffable. Admirable.
Nathalie Crom, La Croix, 9 janvier 2003L’homme est. Il fait face, « avec un désir aveugle d’être là. » Seul. « Il y a loin jusqu’au prochain », toujours. Il regarde, il touche, il sent. En face, les éléments du monde : la pierre, le fleuve, la neige, la montagne, le marécage – et les animaux, qui pensent, qui savent, eux peut-être. L’homme se tient en face, puis s’approche discètement, ou se heurte violemment. « On essaie de participer à tout ce qu’il faut » car tout est « avertissement muet ». C’est ce que disait Rilke, à sa manière : « Et tout était mission ». Pour Vesaas aussi, ce qui importe c’est de coïncider, ne fût-ce qu’une seconde, avec ce que la matière montre, ou provoque. L’homme se parle, en lui, face à tout cela qui vit et se
métamorphose, c’est un long monologue intérieur, des litanies de phrases lourdes, mots-blocs, phrases-murs – et parfois un cri : «Dis quelque chose, bouche», lance-t-il aux pierres chaudes.
Partout, une attention aux détails, à la lumière, au silence. Il y a ce qui est insaisissable et fragile. Comme l’odeur de la première pluie sur une mince robe au-dessus d’un épiderme chaud. Et chaque chapitre de cette œuvre exigeante et crépusculaire s’éteint dans le silence. Comme un retour aux sources.
Christian Desmeules, Le Devoir, 19/20 juillet 2003