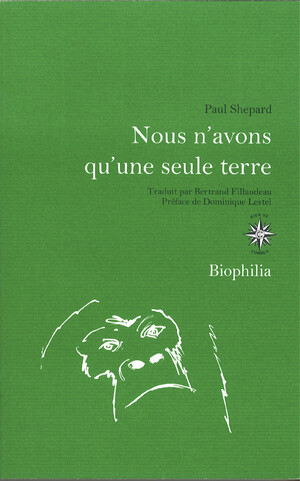Nous n’avons qu’une seule terre
Traduction de Bertrand Fillaudeau.
Brillant et provocateur, sont deux des qualificatifs fréquemment associés à l’Américain Paul Shepard qui, en 1996, dans Nous n’avons qu’une seule terre, composa à partir de cinq de ses livres une sorte d’introduction et de résumé de son œuvre. Son approche est profondément originale, iconoclaste, dérangeante, stimulante, drôle parfois et claire, poétique toujours.
Les principaux sujets de réflexion de Paul Shepard sont éternels : d’où venons-nous, où allons-nous et comment ; qu’est-ce qui constitue l’essence de notre humanité ; d’où vient notre conception du paysage, des animaux, de la terre ; la nature et la culture sont-elles compatibles ?
Le début de l’agriculture, en général considérée comme l’aube de l’humanité, ne marque-t-il pas au contraire le début de la catastrophe car en nous séparant du vivant et en devenant des agriculteurs, nous avons modifié notre rapport au monde, notre rapport à la terre. Nous sommes passés de l’époque des chasseurs-cueilleurs à celle des agriculteurs puis à celle des esclaves de l’économie. Ces mutations profondes ont-elles marqué un progrès, comme on a voulu nous le faire croire depuis toujours, ou ont-elles été l’entrée dans un engrenage absurde. L’augmentation constante de la population sur une terre, aux ressources limitées par essence, devant aboutir tôt ou tard à une catastrophe généralisée. Bien avant que le thème de L’effondrement, de Jared Diamond, n’en ait convaincu plus d’un, Paul Shepard nous avait avertis, toutes les civilisations sont mortelles, nous devons chercher des solutions et arrêter de faire les autruches.
Paul Shepard, qui fut un des premiers philosophes environnementalistes, nous montre que c’est en nous-mêmes que nous trouverons la force de repenser le monde. Savoir d’où nous venons pourra nous aider à savoir où nous voulons aller.
Préface de Dominique Lestel
Presse et librairies
Mais le philosophe de l’écologie va plus loin. Il montre qu’en nous coupant de nos origines animales, de ce qui fut pendant les deux millions et demi d’années du Pléistocène jusqu’à la fin du Paléolithique, notre coexistence avec le monde des bêtes, nous dénaturons notre propre complexion d’êtres humains, et en dégradant notre environnement nous la mutilons et déformons notre ontogenèse.
Jacques Munier, revue Terrain n°60Et l’importance d’un texte comme celui-ci, rigoureux mais dont l’exigence est aussi « esthétique », est de rappeler que l’écologie précède le politique. Qu’elle est par-delà.
Emmanuel Requette, Librairie Ptyx, Bruxelles