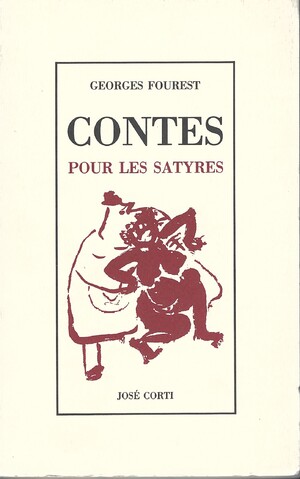Né le 6 avril 1867 à Limoges, Georges Fourest suit des études de droit qui font de lui un « avocat loin de la cour d’appel », comme il aime à se nommer, vient à Paris, où il fréquente les milieux littéraires, collabore à plusieurs revues (La Connaissance, Le Décadent) et se rend célèbre avec La Négresse blonde (Messein, 1909, rééd. Corti 1986), préfacé par Willy. Placé sous le patronage de Rabelais, « Le Duc, le Roi, le Maître », ce recueil qui aime la plaisanterie scatologique, l’allusion gaillarde et la métaphore burlesque cultive en fait l’intellectualisme puisqu’il ne cesse de travestir d’autres textes, en résumant parodiquement les grandes pièces du théâtre classique (« Carnaval de chefs-d’œuvre ») ou en pastichant les poètes du XIXe siècle comme Verlaine, Laforgue ou Mallarmé dont il est nourri (les « pseudo-sonnets »). Constant dans la futilité et indifférent aux transformations de la littérature d’après-guerre, Georges Fourest fait encore paraître Contes pour les satyres (Messein, 1923, rééd. Corti, 1990) et Le Géranium ovipare (Corti, 1935, réé. 1984), qui respirent une même atmosphère ludique et lubrique. Il meurt à Paris le 25 janvier 1945, mais après une période de désaffection, il est peu à peu redécouvert à mesure que se manifeste un regain d’intérêt pour la littérature 1900 : à la lumière des préoccupations contemporaines, ce « Fol de Cour » (Willy) devient un précurseur de l’hypertextualité et son culte de la dérision apparaît comme une ultime parade opposée au néant du monde.
"Qui était-il ? "Ce poète, qui écrivait des vers fort peu bourgeois, vivait comme un bourgeois. Il avait des rentes provenant, je crois, de ses propriétés du Limousin et qui lui permettaient de mener une vie libre de lettré et de curieux. Il était bon père et bon époux, heureux dans sa famille et ne se signalait par aucune excentricité particulière. Au physique, on remarquait sa barbichette pointue et sa calvitie. Mais si Georges Fourest aimait la blague, si ses vers sont souvent pleins d’humour noir ou de fantaisie légère, il était avant tout un lettré. Grand amateur des petits poètes du XVIIe siècle, Scarron, Saint-Amant, Colletet, d’Assoucy, qu’il reconnaissait pour ses prédécesseurs, il avait également une forte culture philosophique et même théologique (car cet iconoclaste qui plaisantait même sur sa propre mort était un catholique pratiquant). Amoureux des Belles-Lettres, il haïssait les sciences au point de donner dix francs à son fils quand celui-ci avait un zéro en mathématiques."
Claude Bonnefoy
"Quand j’ai connu Georges Fourest, il était dans la soixantaine et déjà célèbre. Il ne ressemblait pas plus à l’idée qu’un lecteur de La Négresse blonde pouvait se faire de lui que le Gracq qu’on imaginait au moment de la publication du Château d’Argol ne ressemblait au Gracq réel. Le poète, qui époustouflait les foules et rêvait d’un enterrement délirant, était un homme tout à fait posé et – sauf quand à Deauville il portait veste blanche et casquette de yachtman – vêtu de la classique et déjà désuète jaquette et coiffé du melon dont le règne touchait aussi à sa fin. Il avait l’air bonhomme d’un chef de bureau de ministère. Il n’en avait pas moins écrit La Négresse blonde pour son plaisir et le nôtre. Littérairement, ce livre singulier n’appartient à aucune école, sauf la fourestière, comme dit l’à-peu-près de Willy. Il y a des gens qui deviennent célèbres à force de travail, ou de constance, ou d’acharnement ; qui entassent Pélion sur Ossa jusqu’à forcer l’attention. À Fourest, la célébrité était venue, d’un coup, après une incubation et maturation des plus lentes, le jour où il avait fait paraître sa Négresse. Il y aura bientôt soixante ans que le succès de ce petit livre se maintient avec une aimable régularité, et trente qu’elle est entré chez moi, après des années de vagabondage, tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre."
José Corti, Souvenirs désordonnés
Dans ses livres, la fantaisie s’autorisait toutes les licences et la verve, toutes les virtuosités de la poésie doctorale. Un pitre mais de l’espèce savante. Un bouffon, mais souverain du royaume. Un mage, mais qui éteignait les étoiles pour que la nuit soit plus noire et plus énigmatique. Il a lu Jarry, et il s’est fait lire de Prévert.
P. V.
Georges Fourest devint un ciseleur d’archaïsmes troublants, d’impropriétés volontaires, d’oxymores et d’anacoluthes, toute une faune rhétorique venue en droite ligne de la décadence. Ses Contes pour les satyres sont brillants de mauvais esprit ironique, entre Jarry et Villiers de l’Isle-Adam. Il y fait, entre autres, l’apologie du souteneur qui sait « réduire à son double rôle de bête de somme et de bête à plaisir l’être aux cheveux longs et aux idées courtes ».
Manuel Carcassonne En savoir plus.